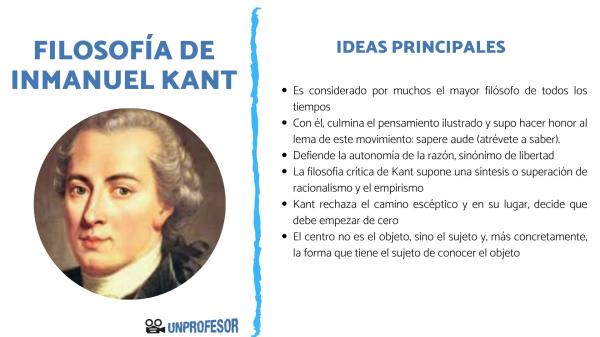Emmanuel Kant a publié Idée d'une histoire universelle cosmopolite en 1784, trois ans après son opera magna : Critique de la raison pure. Partant des affirmations épistémologiques de ce livre, selon lesquelles nous ne pouvons pas affirmer la réalité ontologique ultime de Dieu, de l'ensemble des phénomènes (la Nature) et du moi[1], Kant tente de développer, dans ses œuvres ultérieures, ce que devraient être les positions du philosophe sur diverses questions pratiques, telles que la morale et la politique.Pour affirmer (ou plutôt, qu'il est impertinent de parler) l'existence de ces trois idées de la raison pure, le penseur de Königsberg veut discerner comment nous devons réguler l'activité humaine.
L'un des textes les plus importants sur cette question est l'ouvrage susmentionné Idée d'histoire... Cet article cherche à déterminer si l'histoire humaine a une finalité et quelle est cette finalité, en se basant sur une conception téléologique de la nature, selon laquelle : "...la finalité de l'histoire humaine ne se trouve pas dans sa propre histoire, mais dans l'histoire de l'humanité". Un organe qui ne doit pas être utilisé, une disposition qui n'atteint pas son but, est une contradiction dans la doctrine téléologique de la nature. [Ainsi, pour étudier le sens de l'histoire, Kant soutient qu'il est nécessaire d'opter, dans l'ambivalence des paralogismes, pour une conception finaliste de la nature, où au début et à la fin de toute la série des phénomènes il y a une cause ultime. Ceci, bien que cela puisse sembler à première vue une trahison des déclarations critiques sur la raison pure, n'est pas le cas, puisque3] Kant utilise donc cette conception de la nature comme base de son analyse des affaires humaines.
Sur la base de ces hypothèses téléologiques, Kant estime que ". lorsque l'histoire contemple le jeu de la liberté humaine en bloc, elle peut peut-être découvrir dans son cours régulier [...] comme une évolution progressive et continue, même lente, de ses dispositions originelles 5] Or, quelles sont ces dispositions originelles de l'homme dont parle Kant ? La raison comme organe de direction de l'action humaine, ou selon les termes du penseur allemand : "... la raison comme organe de direction de l'action humaine, ou selon les termes du penseur allemand : "...". La raison est la capacité d'une créature à étendre les règles et les intentions de l'utilisation de toutes ses forces au-delà de l'instinct naturel. "6] C'est-à-dire que, pour Kant, le cours naturel de l'homme produit qu'il soumet progressivement ses instincts naturels à sa capacité rationnelle, devenant ainsi maître de son action. 7] Cela se produit comme un développement nécessaire de la Nature elle-même dans l'homme, et non comme une possibilité de plus dans un ensemble désordonné.
Cependant, pour Kant lui-même, cette évolution n'est pas consciemment motivée par l'homme, mais se produit plutôt malgré lui. Ce que Kant observe dans l'histoire de l'humanité, c'est un conflit constant d'intérêts, et rien n'est plus éloigné de la rationalité proposée que la guerre et les injustices qui peuplent les générations d'hommes. C'est pourquoi : " Le philosophe n'a d'autre recours - puisqu'il ne peut présupposer aucune finalité rationnelle propre à l'action globale de l'homme - que d'essayer de découvrir dans ce déroulement absurde des affaires humaines une intention de la Nature. [8]".
En d'autres termes, la finalité rationnelle de l'homme se réalise sans qu'il en soit conscient, plongé qu'il est dans ses conflits passionnels. Comment cette chose apparemment paradoxale se produit-elle ? Par l'antagonisme humain essentiel, qui est la fameuse sociabilité insociable. Kant affirme que celle-ci consiste en "...la sociabilité insociable de l'homme". que leur propension à vivre en société est inséparable d'une hostilité qui menace constamment de dissoudre cette société ".[9]
Ce concept sous-tend l'affirmation selon laquelle l'homme, pour développer sa capacité rationnelle, doit se rapporter à ses semblables, mais se différencier d'eux et tenter de s'imposer à eux. Un exemple utile, que Kant lui-même mentionne, est la quête de la célébrité : à travers elle, nous recherchons la reconnaissance des autres hommes, mais en nous démarquant d'eux, en les surpassant.Grâce à cette tension constante entre la société et l'individu, l'espèce humaine développe ses capacités, progresse en tant que tout, de l'homogénéité primitive à l'union individualisée, et est ainsi en mesure d'atteindre ses objectifs.Dans ce parcours historique, qui est un processus social et non individuel, ces acquis seront établis sous forme d'états et de droits communs aux hommes, comme des sortes de limites à leur conduite qui leur permettent de passer du libertinage à la liberté, à la juste conduite de leurs âmes. Dans cette ligne, il affirme que : " Une société dans laquelle la liberté sous les lois extérieures est liée dans la plus large mesure possible à une puissance irrésistible, c'est-à-dire une constitution civile parfaitement juste, doit être la tâche la plus élevée de l'espèce humaine. [10]".
En d'autres termes, la société parfaite sera celle dans laquelle les hommes adoptent librement les lois qui leur sont imposées et où leur volonté coïncide pleinement avec la loi en vigueur. Cependant, pour Kant, cet idéal n'est pas vraiment réalisable, car " ... la société parfaite est une société dans laquelle les lois sont librement adoptées par les hommes et où leur volonté coïncide pleinement avec la loi en vigueur ". Dans un bois aussi tordu que celui dont l'homme est fait, rien ne peut être sculpté de façon entièrement droite. "Le concept de sociabilité insociable a été le point de départ des grandes philosophies ultérieures de l'histoire, en particulier la dialectique hégélienne et marxiste, où les contraires sont dépassés et réunis dans un processus cumulatif.Tous ces systèmes partent du principe que la contradiction et le conflit sont des étapes nécessaires, mais non permanentes, de l'histoire humaine. Dans la théorie kantienne, cette contradiction disparaîtra (ou nous devrions penser qu'elle disparaîtra) dans une vie au-delà de la mort, car ici la réalité phénoménale est sans fin et n'est pas le fondement ultime de l'être. Selon toutes ces théories, il y a un progrès dans la vie de l'homme et dans la société.La conception de Kant était basée sur sa notion téléologique de la Nature ; ainsi, les étapes de l'histoire se succèdent pas à pas. Je crois que ce présupposé est la principale faiblesse de toutes ces théories, car elles conçoivent l'histoire de manière substantialiste, comme s'il s'agissait d'un processus unitaire.
Contrairement à ces propositions (y compris la proposition marxiste originale), les philosophes ultérieurs, en particulier dans la tradition matérialiste, préconisent une conception de l'histoire comme un ensemble de peuples divers et de leurs actions, et non comme un processus organisé (consciemment ou inconsciemment). Par exemple, Gustavo Bueno, dans L'Espagne vis-à-vis de l'Europe ¸ déclare que " L'idée d'histoire, du point de vue philosophique, est intrinsèquement une idée pratique [...] ; mais les opérations sont effectuées par des hommes individuels (agissant en tant que groupe), et non par l'"Humanité". Dans cette perspective, qui modifie le paradigme d'observation de l'histoire, il n'est pas permis de penser l'histoire comme une entité dont les parties agissent dans une direction uniforme. L'histoire est plutôt la somme des projets historiques des différentes nations humaines. La forme moderne de l'histoire présuppose cependant la subsomption des projets nationaux passés dans les projets ultérieurs. Il n'est donc pas possible de penser l'histoire comme une entité dont les parties agissent dans une direction uniforme.Cette position était défendable pour les penseurs occidentaux des XVIIIe et XIXe siècles, qui voyaient l'Europe dominer le monde et être le fer de lance intellectuel et social[13]. Aujourd'hui, cependant, alors que la prééminence économique s'est déplacée vers l'Asie du Sud-Est, la prééminence économique s'est déplacée vers l'Asie du Sud-Est :Serions-nous prêts à accepter que nous ayons participé à un processus dont nous n'avons même pas eu conscience et qui conduira à la société parfaite en Corée du Sud, par exemple ?
Le présupposé progressiste de l'histoire n'étant qu'un présupposé, je crois qu'il est non seulement difficile à accepter lorsqu'on n'est pas la société prééminente, mais aussi problématique sur le plan pratique. En effet, la conception selon laquelle toutes les actions, quelles qu'elles soient, conduisent progressivement à une amélioration du monde humain, conduit à la justification, ou au conformisme, avecLe fait que les actions négatives aient des conséquences positives ne nous permet pas de supposer que ces conséquences sont finales et définitives. En d'autres termes, si - comme le dira plus tard Hegel - tout ce qui est réel est rationnel, quelle raison pourrait-on avoir d'essayer de transformer quoi que ce soit ? Néanmoins, Kant affirme que : " ...le réel n'est pas rationnel. Or les maux qui en découlent obligent notre espèce à chercher dans cette résistance mutuelle de nombreux États, résistance profitable en elle-même et découlant de leur liberté, une loi d'équilibre et une puissance unifiée pour la soutenir, les obligeant ainsi à établir un État cosmopolite de sécurité publique étatique. [14] ".
Si l'on considère l'État cosmopolite que l'on pourrait identifier à l'ONU, il se peut que cette organisation, plutôt qu'un équilibre entre égaux, conduise à l'imposition d'un État sur les autres (ce qui se produit effectivement[15]). Que cette imposition conduise à une meilleure situation n'est qu'un espoir qui n'est pas étayé par des prémisses philosophiques stables. D'autre part, la relation kantienneL'éthique, qui repose sur les impératifs catégoriques, est fondée sur le principe d'un conflit progressif menant à l'amélioration de l'humanité. a priori de l'expérience, a pour fondement ultime l'affirmation de l'existence d'une divinité absolument juste et de l'immortalité de l'âme [16], toutes deux affirmées dans la grande majorité des religions. Ainsi, bien que Kant conçoive la morale comme distincte de la religion, il estime que la religion a été son affirmation historique dans ses différentes manifestations. C'est ce que Kant appelle les religions de l'amour et de la paix.Pour Kant, la religion abandonnera progressivement ses éléments irrationnels pour devenir la socialisation d'une morale rationnelle.
Le processus qui y conduira est celui des révolutions, mais pas au sens classique du terme. Kant est modéré, et pense que la violence est plutôt un symptôme de notre incomplétude, l'outil ultime du changement social. Les révolutions sont donc un changement de paradigme et de pensée, mais un changement progressif : Kant est profondément déçu par les Lumières jacobines,17] Ainsi, les révolutions doivent conduire à la diffusion de la religion morale, grâce à laquelle le mandat politique et l'obligation éthique coïncideront dans la société.
Voir également: Mars dans la 9ème maisonD'après la théorie kantienne, nous sommes obligés de supposer que ce processus est en cours si nous voulons que les injustices historiques ne restent pas impunies. Et c'est certainement le cas. Cependant, que gagnons-nous, ou plutôt que gagnent les victimes de ces injustices, d'une rédemption... ? post mortem ... Peut-être, au lieu de chercher une justification définitive à ces maux, devrions-nous penser qu'ils ne pourront jamais être restaurés, qu'ils sont passés et qu'il n'y a aucun moyen de réparer ce qui s'est passé. De cette façon, nous affronterions les maux historiques avec un poids plus important que celui qu'on leur donne habituellement, comme quelque chose qu'il faut éviter autant que possible et qui, lorsqu'il conduit à la mort d'une personne, ne peut être effacé.Ainsi, avec Horkheimer, nous pourrions dire que ". Dans cette fonction, la philosophie serait la mémoire et la conscience de l'humanité et contribuerait ainsi à ce que la marche de l'humanité ne ressemble pas à l'errance insensée des détenus dans les institutions pour prisonniers et malades mentaux pendant leurs heures de récréation. [En d'autres termes, nous serions confrontés à une obligation fondamentale d'éviter autant que possible l'injustice, qui nous entraînerait ainsi dans un processus qui n'est pas déterminé vers un bien ultime, mais qui semble nous conduire, si nous ne faisons pas autrement, à une catastrophe sans précédent.
[1] Kant, I. (2018), Deuxième division, Dialectique transcendantale, Livre II, Chap. I et II. In : Dialectique transcendantale, Livre II, Chap. I et II. In : Dialectique transcendantale, Livre II, Chap. I et II. Critique de la raison pure Trad. par Pedro Ribas, Barcelone : Gredos.
[2] Kant, I. (2018). Idée d'une histoire universelle cosmopolite (p. 331) AK. VIII, 17. Traduit par Concha Roldán Panadero et Roberto Rodríguez Aramayo, Barcelone : Gredos.
[En d'autres termes, Kant utilise le concept de Nature téléologique comme une hypothèse nécessaire pour guider les actions humaines vers une fin, et non comme un énoncé théorique pur et simple, car le domaine de la raison pratique est celui dans lequel l'homme concrétise ses idées, par opposition à la raison pure, qui ne définit que ce que l'homme rencontre dans le monde.
[Cette notion téléologique de la nature a été contredite non seulement par la biologie évolutionniste moderne, mais aussi par des philosophes contemporains ou antérieurs à Kant, tels que Spinoza ou Épicure, qui niaient l'existence d'une causalité transcendante dirigeant le cours de la nature.
[5] Kant, I. : op. cit. ., p. 329
[6] Kant, I. : op. cit. . p. 331, AK VIII, 18-19
[Le célèbre texte de Kant trouve ici un écho Qu'est-ce que l'illumination ?
[8] Kant, I., op. cit. p., 330, AK. VIII 18
Voir également: Homme Sagittaire et Femme Taureau : Un couple de signes compatibles ![9] Kant, I. : op. cit. . p. 333, AK VIII, 20
[10] Kant, I. : op. cit. pp. 334-335, Ak. VIII, 22
[11] Kant, I., op. cit. p. 336, Ak. VIII, 23
[12] Bueno, G. (2018). L'Espagne vis-à-vis de l'Europe. (p. 37) Oviedo : Pentalfa.
[Kant a raison de parler de l'Occident en des termes tels que : "notre partie du monde (qui fournira probablement un jour des lois au reste du monde)", op. cit. Cette affirmation n'est cependant pas absolue, mais seulement relative à quelques siècles après son époque.
[14] Kant, I., op. cit. p. 338, Ak VIII, 26.
[Il est clair que l'ONU est constituée en accordant des privilèges à certains États par rapport à d'autres, comme en témoigne le droit de veto des États-Unis, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France.
[16] Sur cette affirmation, voir Doctrine transcendantale de la méthode, chapitre II, Le canon de la raison pure, Critique de la raison pure, En effet, l'activité pratique repose sur l'affirmation praxéologique des idéaux de la raison pure, puisque ces idéaux justifient les fameux impératifs catégoriques.
[Un exemple clair de ce rejet catégorique de l'usage de la violence est son traité Sur la paix perpétuelle dont l'article premier est libellé comme suit : " Un traité de paix conclu sous la réserve mentale de certains motifs susceptibles de provoquer une nouvelle guerre dans l'avenir ne doit pas être considéré comme valable. "En d'autres termes, la violence doit être catégoriquement éliminée de la sphère humaine.
[18] Horkheimer, M. (2010). Critique de la raison instrumentale (p. 187) Trans. par Jacobo Muñoz- Madrid : Trotta.
Si vous souhaitez connaître d'autres articles similaires à Une critique de la philosophie de l'histoire de Kant vous pouvez visiter la catégorie Autres .