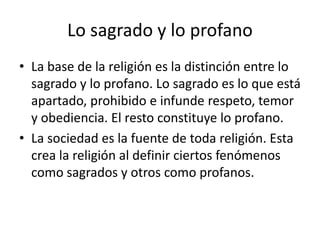Dans le précédent article consacré à la pensée d'Émile Durkheim (1858-1917), nous avons précisé qu'il ne fallait pas faire une lecture matérialiste ou réductrice de l'ensemble de son œuvre. sentiments inconscients dans son analyse de la conscience collective, après avoir constaté que les institutions morales et sociales provenaient, non pas de raisonnements et de calculs, mais de causes et de motifs obscurs qui n'ont aucun rapport avec les effets qu'ils produisent et ne peuvent donc pas être expliqués[1]. Un exemple classique serait celui de la religion, sujet que nous aborderons dans cette section.
Ceci étant dit, le concept proposé par Durkheim doit être distingué de celui des inconscient collectif Durkheim, inventé par le psychiatre suisse Carl G. Jung, qui mérite néanmoins une brève comparaison. Durkheim a distingué tout au long de son œuvre entre conscience collective y la conscience individuelle Il fera également une distinction similaire entre la personnalité et l'individualité, affirmant qu'elles ne peuvent être traitées comme de simples synonymes. La personnalité est paradoxalement impersonnelle, car elle est constituée d'éléments supra-individuels provenant d'une source extérieure, tandis que l'individualité est liée aux traits biochimiques de chaque être humain. Les gens perçoivent le monde de différentes manières.Ces représentations collectives se trouveraient dans la conscience collective, et leur intériorisation dans les individus fournit les caractéristiques génériques de la collectivité dans laquelle nous vivons. En d'autres termes, elles ont un impact inconscient sur la conscience individuelle, et même la transcendent, parce qu'elles font partie de la conscience collective, et qu'elles ne sont pas seulement une partie de la conscience collective, mais aussi de la conscience collective.Ainsi, selon la société dans laquelle nous nous trouvons (rappelons que nous sommes dans une société plus supérieure et plus durable qu'elles : la société. Pour Durkheim, il n'existe pas de société universelle. Des représentations qui la transcendent car, même si un individu meurt, la société continue son chemin sans être perturbée, de sorte qu'elle est supérieure à l'être humain.
D'autre part, en fonction de la complexité du processus de socialisation, qui ne se fait jamais de manière homogène, les individus introduisent des modifications dans les représentations collectives en fonction de leur expérience de vie. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse ici, le sacré, bien que composé d'éléments plus ou moins communs à toutes les sociétés, présente des nuances différentes au sein de chaque société.Il est vrai que le sacré en tant que tel se soucie peu de ce fait, puisqu'il fait partie de quelque chose qui dépasse largement l'individu. Comme nous le verrons plus loin, Durkheim confond, comme beaucoup de penseurs de son époque, complexité et supériorité. Nous avons déjà vu comment Auguste Comte considérait la complexité et la supériorité comme des éléments essentiels de la vie sociale.la sociologie comme une science supérieure parce qu'elle est, selon lui, la plus complexe de toutes les sciences.
Pour Jung, les archétypes fonctionneraient de manière similaire, comme des représentations de ce qu'il appelle la totalité de la psyché, du moi, qui émergeraient en tant que symboles de l'inconscient collectif et se manifesteraient lorsque la conscience en aurait besoin.En somme, il s'agirait des parties d'un tout, dont la manifestation est liée aux symboles, rites et mythes présents dans l'histoire de l'humanité. Pour que le processus d'individuation, nécessaire à la réalisation de chaque être humain, puisse avoir lieu, les archétypes apparaissent comme les miettes d'un tout.Par exemple, un archétype lié aux rites archaïques est celui de l'initiation. Tout être humain doit passer par un processus initiatique qui le conduit à participer à la transcendance, au sacré. Bien que la sécularisation de la société ait désacralisé et démystifié cette pratique, tout être humain traverse des moments de crise existentielle et de souffrance qui seraient autant d'épreuves initiatiques. L'initiation pourrait se reconnaître dans des symboles archétypaux présents dans les rêves ou les visions de l'inconscient (représentations collectives, en termes durkheimiens) symbolisant le rite de passage à la maturité psychologique, qui impliquerait de sortir de l'irresponsabilité infantile.
Alors que la conscience collective durkheimienne se situerait à un premier niveau, plus proche de la conscience, l'inconscient collectif se situerait à un niveau plus profond. Les représentations collectives de Durkheim soulignent l'inquiétude du sociologue entre la dichotomie de l'individu et de la société, à laquelle il attribuaitdes propriétés dynamiques. De même que la société est intériorisée dans l'individu, l'individu est intériorisé dans la société. En d'autres termes, l'individu n'est pas seulement composé d'une partie sociale, sans rapport avec sa constitution biologique, qui est changeante et variable selon les différentes sociétés (s'il n'y a pas de société universelle, il n'y a pas non plus de nature humaine universelle), mais ce même individu s'extériorise et influence la société, en la modifiant et en introduisant des processus de changement. Ainsi,la partie sociale de l'être humain, constituée de toute l'histoire de la société, est également ancrée à un niveau plus profond, de telle sorte qu'elle échappe à toute analyse basée exclusivement sur l'intellect.
Au Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) Durkheim a cherché à découvrir l'origine des représentations collectives en analysant ce qui était alors considéré comme la plus ancienne de toutes les sociétés : la société aborigène australienne. Dans son étude de la religion totémiste, Durkheim a constaté que Les représentations symboliques totémiques étaient des représentations de la société elle-même. Les symboles totémiques fonctionnaient comme des matérialisations de l'âme sociale dans des objets physiques, des animaux, des plantes ou un mélange des deux, et ils remplissaient la fonction de cohésion sociale que le sociologue attribuait à la religion. Par exemple, lorsque les tribus utilisaient la représentation d'un jaguar dans leurs cérémonies, elles imitaient ce jaguar, de sorte que l'objet du symbole totémique était le jaguar.Ces rites étaient pratiqués afin, par exemple, d'améliorer la chasse, de sorte qu'en représentant l'animal, les membres de la tribu devenaient le même animal, atteignant ainsi leurs objectifs. Ainsi, selon le sociologue, les dieux ne sont rien d'autre que des forces collectives, incarnées dans une forme matérielle La supériorité des dieux sur les hommes est la supériorité du groupe sur ses membres [2].
Mais d'où vient la dichotomie entre sacré et profane présente dans la plupart des systèmes religieux ? Des théories telles que l'animisme ou le naturisme affirment que cette distinction trouve son origine dans des phénomènes physiques ou biologiques naturels. D'autres affirment qu'elle trouve sa source dans les états de rêve, où l'âme semble quitter le corps et entrer dans un autre monde régi par ses propres valeurs.D'autre part, on trouve des hypothèses suggérant que les forces de la nature et les manifestations cosmiques sont la source du divin[3].
Il n'est certes pas anodin de s'arrêter sur un sujet qui a suscité à la fois rejet et fascination tout au long de l'histoire de l'humanité. Durkheim a été très clair : ni l'homme ni la nature ne comportent le sacré comme élément constitutif, il faut donc, pour qu'il se manifeste, une autre source qui, pour lui, ne peut être que la société. Les rencontresLes cérémonies, contrairement à la vie quotidienne, provoquaient une effervescence chez les individus, qui perdaient conscience d'eux-mêmes et s'unissaient à la tribu dans son ensemble. En bref, la source du monde religieux est une forme d'interaction sociale que les individus perçoivent comme un autre monde C'est dans ce sens que s'inscrit l'importance des rituels, comme moyen de sacraliser le quotidien, de le séparer et en même temps de donner une cohésion à la société en matérialisant des aspects d'elle-même sous forme de rites ou d'objets.
L'ensemble du milieu social nous apparaît ainsi comme habité par des forces qui, en réalité, n'existent que dans notre esprit. On le voit, Durkheim accorde une importance fondamentale au symbolique dans la vie sociale, s'intéressant aux relations entre l'esprit et la matière, ce qui obsédera également Jung. La signification des objets ne découle pas de leurs propriétés intrinsèques, mais du fait qu'ils sont des symboles des représentations collectives de la société. Les idées ou représentations mentales sont des forces qui dérivent du sentiment que la collectivité inspire à ses membres et qui dépendent toujours de la croyance de la collectivité en elles [4]. On retrouve ici l'idée de la nécessité d'une légitimité des formes sociales pour le fonctionnement de la société que défendent les théoriciens du consensus social. Les institutions sociales existent et fonctionnent.Ce serait une confirmation du célèbre théorème de Thomas : "...la façon dont ils le font, aussi longtemps que la croyance en eux est maintenue. si les individus définissent une situation comme réelle, elle sera réelle dans ses conséquences "Le sociologue Robert K. Merton a utilisé le théorème de Thomas pour définir ce qu'il a appelé la prophétie autoréalisatrice, en analysant les phénomènes qui se sont produits lors du krach de 1929. Lorsque la fausse rumeur selon laquelle les banques étaient insolvables s'est répandue, tout le monde s'est empressé de retirer ses dépôts auprès d'elles, et les banques ont effectivement fait faillite. Les croyances, en bref, sont des forces puissantes dont les conséquences peuvent être objectives et tangibles, et pas seulement subjectives. En d'autres termes, les relations entre la psyché et la matière pourraient entretenir un dynamisme et une réciprocité bien plus importants qu'il n'y paraît à première vue.
Voir également: Quelle est la signification du nom Ángeles ?Jung l'illustre par son concept de synchronicité. Une synchronicité est un phénomène qui échappe à toute explication de cause à effet. Il s'agit d'événements sans relation apparente qui se produisent lorsqu'un archétype est activé, c'est-à-dire deux événements qui se produisent simultanément et qui sont liés par une signification de manière acausale[5]. Il s'agit de coïncidences significatives que l'inconscient tisse et dote d'un sens.Durkheim analysera également l'origine de l'idée de cause, ainsi que des concepts de temps et d'espace qui régissent les catégories de la pensée humaine. Pour Durkheim, il ne s'agit pas de concepts qui semblent aller de soi. a priori Le rythme de la vie a donné naissance à l'idée de temps, et la répartition écologique de la tribu aux premières notions de la catégorie d'espace. Le concept de causalité comme lien entre les phénomènes répondrait à la même relation. David Hume avait souligné que notre expérience sensorielle de la nature ne pouvait pas, à elle seule, nous conduire à la catégorie logique de l'espace.cause. Nous percevons une succession de sensations, mais rien n'indique qu'il existe une relation de cause à effet entre elles. Cette relation, selon Durkheim, implique l'idée d'efficacité. Une cause est quelque chose qui peut provoquer un certain changement ; c'est un pouvoir qui ne s'est pas encore manifesté en tant que force, et l'un de ses effets est la réalisation de ce pouvoir. Dans les sociétés primitives, cette force était l'eau. mana , wakan u orenda Ainsi, le fait que l'intellect accepte sans discussion l'idée de causalité est le produit d'un conditionnement social de longue date, qui trouve ses sources dans le totémisme. Rappelons comment la représentation d'un jaguar dans les cérémonies consacrées à la chasse a été convertie de manière efficace,Penser logiquement, c'est penser de manière impersonnelle, sub especie aeternitatis [Et si la vérité est intimement liée à la vie collective, et que l'on assume l'idée des archétypes jungiens comme des capsules de cette vérité primitive qui stagne dans les profondeurs de l'inconscient, peut-être que l'idée de l'image de l'homme dans le monde est aussi une idée de l'homme dans le monde. synchronicité peuvent avoir beaucoup plus de poids dans l'explication des relations causales que ne le suggèrent les études classiques.
En effet, l'accent mis par Durkheim sur l'origine sociale de toutes les catégories régissant la pensée humaine est tel que, dans un certain sens, il a donné à la société la position que Dieu lui-même occupait dans la religion. Dieu est la société qui se révère elle-même, et la religion est donc fondée sur la réalité La société aurait fait de l'homme ce qu'il est, en le libérant des liens de la nature animale et en le transformant en un être moral. En fin de compte, les croyances religieuses expriment symboliquement et métaphoriquement les réalités sociales, car elles façonnent les réponses à certaines conditions de l'existence humaine. Comme l'affirme l'historien des religions Mircea Eliade, la "religion" est toujourspeut être un mot utile si l'on tient compte du fait qu'il n'implique pas nécessairement la croyance en Dieu, en des dieux ou en des esprits, mais qu'il se réfère uniquement à l'expérience du sacré et qu'il est donc lié aux concepts d'être, de sens et de vérité. Le sacré et les éléments qui le configurent ne font pas partie d'un simple symbolisme obsolète, mais ils mettent à jour des situations existentielles.Si nous comprenons le nihilisme à partir de sa racine étymologique, comme une absence de chose, sans fil (sans relation, sans lien)[8], la religion apparaîtrait comme une forme de "nihilisme". religion L'approche de l'archaïque, du primordial, est sans doute essentielle pour surmonter le vide existentiel qui semble régner dans nos sociétés, mais ce (re)retour ne doit pas être un moyen de surmonter le vide existentiel qui semble régner dans nos sociétés.La question n'est pas de le faire à partir de la naïveté de l'idolâtrie et de l'idéalisation des sociétés anciennes, mais à partir de la compréhension que les sciences humaines permettent, comme une exégèse mythologique et, en somme, une investigation de l'existence des formes symboliques qui ont peuplé l'imaginaire collectif de l'histoire des sociétés depuis l'Antiquité.
[1] Tiryakian, E. (1962) Sociologismo y existencialismo, Buenos Aires : Amorrotou.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Mckenna, T (1993) El manjar de los dioses, Barcelone : Paídos.
[5] Jung, C. (2002) El hombre y sus símbolos, Caralt : Barcelona.
[6] Tiryakian, E. (1962) Sociologismo y existencialismo, Buenos Aires : Amorrotou.
Voir également: Saturne en Cancer dans la 3ème maison[7] Eliade, M. (2019) La búsqueda : Historia y sentido de las religiones, Kairós : Barcelona.
[8] Esquirol, J.M ( 2015) La resistencia íntima, Acantilado : Barcelona.
Si vous souhaitez connaître d'autres articles similaires à Durkheim (II) : Le sacré et le profane vous pouvez visiter la catégorie Autres .